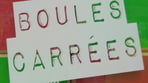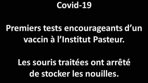Année 2 (18 avril 2018 – 8 avril 2019) : introduction
Les introductions des journaux publiés sont des points d'étape, avec ce que cela induit de décalage par rapport au texte présenté. Ici, il est question d'émancipation et de recentrage. C'est l'un des cadeaux que m'aura offert cette vie un peu différente. Je vous souhaite de trouver également votre itinéraire bis!


Texte intrégal sur la plateforme Atramenta
Voici le récit de l’année 2 : non pas une retranscription parfaite de mon expérience des jours passés, mais un témoignage de mon état d’esprit du moment et de ma perception des faits traversés, vécus, ressentis, observés.
Que de temps il m’aura fallu pour achever cette publication ! J’ai été plus rapide que pour l’année 1, mais alors que je pensais boucler la parution fin 2020, plusieurs mois se sont encore écoulés avant de proposer à la discussion ce nouveau volume. Le délai est en partie dû à de la procrastination, un surcroît de désorganisation avec les animaux vieillissants, la perte début janvier 2021 de Luna et Adam, la course à la validation pour les prénoms. Il y avait aussi le besoin d’infuser, de laisser travailler en sourdine, dans mon cerveau, le bilan que je veux dresser dans cette introduction. Il m’a fallu démêler l’écheveau des différents niveaux qui s’entremêlaient : temps décalés de la rédaction au jour le jour, de la préparation du texte global, des relectures et de l’exposition (sa mise à disposition de tous ceux qui voudront s’en saisir). Et surtout, une forme de lutte contre le quotidien, qui semble perdue d’avance. Pourquoi parler de lutte ? Faut-il préférer l’image d’une bouée enregistrant le mouvement des courants ? Car le fait même de tenir un journal racontant ce quotidien, ce flux banal des activités, est encore une manière de m’y soumettre en voulant le maîtriser. En le racontant, je le hisse au rang de récit. Le banal devient matière à raconter. Rien de plus banal que cette affirmation également, car l’écriture transforme, et c’est bien son intérêt. Mais le quotidien change-t-il de nature pour autant ? Le raconter permet-il d’influer sur le futur immédiat, c’est-à-dire le présent ?
Car le quotidien reste ce monstre qui dévore tout sur son passage : un despote qui m’engloutit encore trop souvent. Le quotidien pèse lourdement sur la vie, malgré son caractère fuyant et cyclique. Il est ce qui ne reste pas, mais revient toujours à faire. Je pense à Annie Ernaux parlant de cet asservissement aux tâches ménagères1 : ces occupations toujours à recommencer, dont les résultats, quels que soient les efforts déployés pour les effectuer, sont voués à disparaître. Un sol balayé a vocation à se salir. Une table mise à être dressée de nouveau. Les activités quotidiennes sont de sable, mais d’un sable qui envahit tout. Or, écrire, créer, revient à se dresser contre ce quotidien. Il faut arracher du temps à ce qui, par définition, ne reste pas. Et cela demande un apprentissage, pour ma part en tout cas.
Je mène ainsi un combat, non pas contre le temps, ni le quotidien, mais contre moi-même, pour organiser en priorité absolue, mes journées sur du dur, du solide : sur ce qui reste du flot des jours, c’est-à-dire les textes et tout le travail productif. Balayer sa maison est important pour garder un cadre de vie agréable et sain, mais je dois parvenir à réduire au maximum mes routines. Depuis que je suis nomade, certaines me prennent plus de temps qu’avant comme aller chercher de l’eau, ranger pour transformer un petit espace pour la nuit, ranger pour le retransformer pour la journée. J’ai encore des marges de progrès.
Cette introduction ne porte pas uniquement sur la deuxième année. C’est plutôt un point d’étape pour témoigner de mon évolution entre celle de l’année 1 (qui était déjà une introduction pour les 3 premières années et non pour le seul récit des douze premiers mois) et mai 2021. En un an, ma vision du nomadisme et de mon expérience a encore bougé, ce qui correspond au cours normal de la vie des idées : quand elles sont travaillées par les mots et le passage des jours, leur conception s’affine ou entraîne sur des chemins réflexifs imprévus. Quand j’ai sorti la version papier de l’année 1 à l’automne 2020, six mois après la version électronique, l’introduction n’était déjà plus complètement en adéquation avec la personne que j’étais devenue. Je n’y ai cependant pas touché. Il est temps d’apporter des précisions et de poser des jalons.
Après 4 années de nomadisme plus ou moins mobile, mais toujours vécu comme une démarche non sédentaire (même pendant des étapes de bivouacs longs comme celui de l’automne-hiver 2019-2020 prolongé par le premier confinement), je suis toujours étonnée de me voir autant transformée. S’agit-il vraiment d’une mue ? Se transforme-t-on vraiment ou ne fait-on que suivre son inclination en travaillant à révéler ses envies profondes ? Qui suis-je aujourd’hui, sinon cette personne solitaire assumée qui préfère son antre silencieux au brouhaha des foules, mais qui ne fait que réfléchir sur l’espace public, celui de la politique telle que l’a définie Hannah Arendt, et qui n’est justement pas celui des foules, même si celles-ci peuvent le traverser et parfois, de manière encore plus effrayante, l’occuper.
Écrire un journal, tenir un journal (expression peut-être plus appropriée, car il s’agit d’agripper des pans de vie qui se délitent et se recomposent en permanence) revient à donner du sens à ce qui n’en a plus, mais qui, cependant, conditionne l’ordre qui nous constitue. Si je suis une personne solitaire, c’est en partie dû à mon addiction au travail, elle-même issue en partie de mon passé d’enfant sage qui avait trouvé dans l’école son échappatoire : son divertissement pascalien. Bien sûr, c’est inexact, car incomplet. Mais ce n’est pas faux, même s’il est impossible de dire que c’est totalement vrai. La reconstruction du passé passe par un sens qui lui est attribué qui, tout en appauvrissant et simplifiant le réel, le rend « lisible » : appropriable. C’est sans doute ce qu’est l’identité : un récit organisateur, qui permet à des éléments épars de flotter dans un même courant et donc d’être en relation, c’est-à-dire mis en récit. Ce journal est sans doute aussi une tentative pour récupérer, garder ou fabriquer de la mémoire dont j’ai été privée ; ce qui est cependant une chance par rapport à ceux qui restent prisonniers d’un héritage familial, matériel et surtout immatériel avec toutes les injonctions à se plier aux besoins de leur groupe d’origine.
L’écriture serait-elle un habit social respectable pour l’adolescente blessée qui, chez ses parents, ne se sentait bien qu’entre les 4 murs de sa chambre ? Qui travaillait sérieusement en classe, car elle était intimement persuadée que son salut passait par là et qui avait aussi identifié que, grâce à son investissement scolaire, elle avait la paix. Je fermais la porte de ma chambre pour travailler, rêver ou lire. On me laissait tranquille. J’étais aux commandes. Ma caravane aujourd’hui est comme ma chambre d’enfant et d’adolescente : un refuge, mais un refuge encore plus rassurant qu’une chambre de 4 murs, car je l’emporte partout avec moi. Dans ma dernière location, je parlais souvent de ma chambre en lieu de place de mon bureau. J’avais une chambre. Mais le bureau était, plus encore que la chambre, un lieu cocon. Ma maison actuelle n’est pas seulement secrète : elle est aussi un espace qui se montre. Puisqu’on m’avait signifié que je n’avais pas ma place, ou tout du moins, que celle que je revendiquais n’était pas celle qu’on m’avait dévolue, la voici matérialisée par mon attelage et, d’une certaine façon, mise en scène : même si je suis le plus souvent dans des lieux très solitaires, Diogène est mon héros.
La transformation la plus radicale, et dont je ne soupçonnais pas la profondeur, tient au processus de libération mentale enclenché par mon nomadisme. Avec cette vie un peu différente de la précédente, j’ai pris confiance en moi et assume désormais d’écrire. Pendant l’année 2, j’ai cheminé sur cette voie de la réappropriation de soi et autoédité, enfin, mon premier roman qui dormait depuis presque 20 ans (pour la version initiale) dans un tiroir numérique.
...